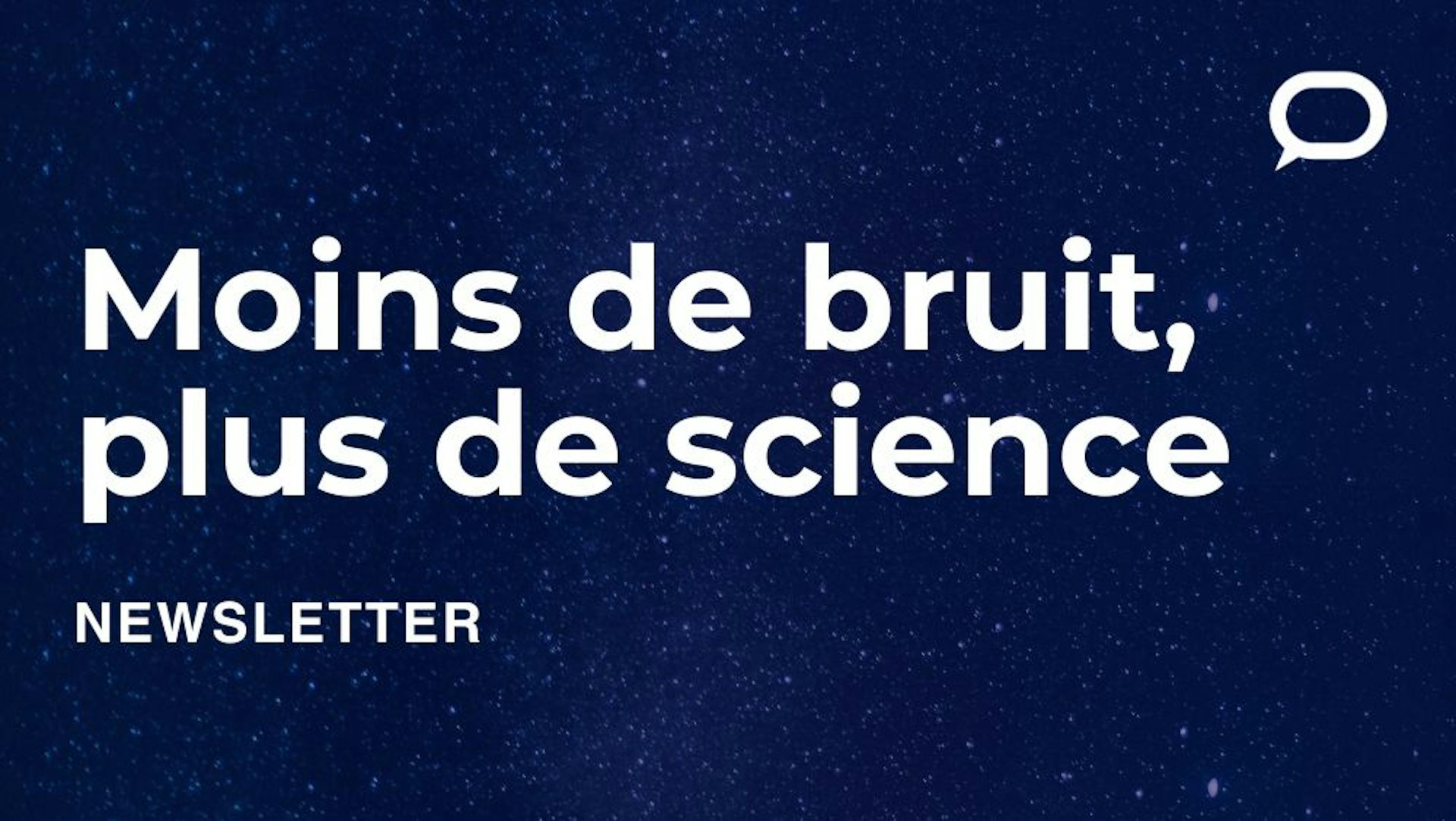La destruction de données scientifiques aux États-Unis : un désastre intellectuel et économique
Depuis le début de l’année 2025, une vague de suppression systématique de données scientifiques s’est propagée à travers les institutions américaines. Plus de trois mille quatre cents ensembles de données ont été effacés des sites gouvernementaux, dont deux mille sont liées directement à la recherche et au développement.
Ces suppressions massives touchent particulièrement le domaine du changement climatique, mais aussi celui de la santé publique et l’équité sociale. Par exemple, les informations sur les taux d’obésité, les suicides parmi les adolescents, le tabagisme et les comportements sexuels ont disparu des sites web du CDC, l’équivalent américain de notre DMI (Direction des maladies infectieuses).
Cette purge numérique a également perturbé les échanges scientifiques internationaux. Des collaborations cruciales entre la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) et des institutions européennes comme le Ifremer ont été interrompues, ce qui pourrait compromettre l’exactitude des alertes météorologiques et climatiques.
Malgré les injonctions judiciaires pour restaurer ces données, la validité des informations reconstituées reste incertaine. Cette situation menace non seulement le progrès scientifique global mais aussi la croissance économique américaine.
Le coût de cette destruction est difficile à quantifier précisément. Le séquençage du génome humain, par exemple, a nécessité un investissement de deux milliards sept cents millions de dollars sur quinze ans et a engendré des bénéfices estimés à plus d’un trillion de dollars grâce à ses applications médicales et biotechnologiques.
Les méthodes d’évaluation économique des données scientifiques, telles que le coût historique ou la valeur de remplacement, montrent clairement l’ampleur du désastre. La reconstitution complète des bases de données supprimées coûterait des milliards et pourrait ne pas être possible pour certaines.
En outre, ces suppressions systématiques menacent la qualité des modèles d’intelligence artificielle qui dépendent de l’accès à des données précises. Sans un environnement de données fiables et représentatives, les progrès technologiques risquent d’être faussés par le biais et l’inexactitude.
Face à cette situation critique, l’Union européenne pourrait jouer un rôle clé en proposant une alternative sûre pour la préservation des données scientifiques mondiales. Son cadre réglementaire exemplaire, comme illustré par le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et l’AI Act entrée en vigueur en août 2024, offre un exemple de gestion éthique et responsable des informations.